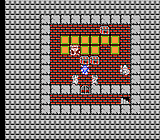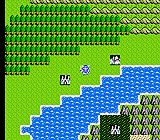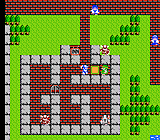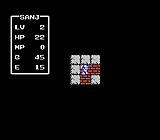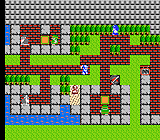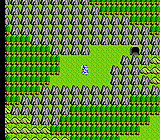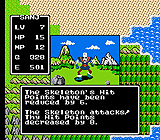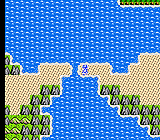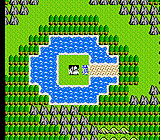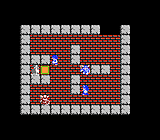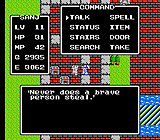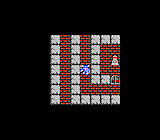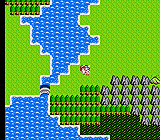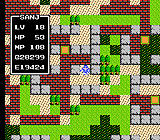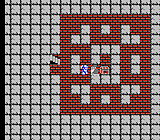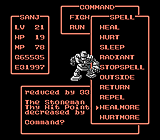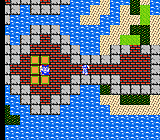|
 |
||||||
  NES NES |
  Super Nintendo Super Nintendo |
  Master System Master System |
  Mega Drive Mega Drive |
  PC Engine PC Engine |
  Neo Geo Neo Geo |
||
| Suppléments: |  Comparaison avec Final Fantasy et Phantasy Star |
 Dragon Ball Quest |
|
 La Genèse |
 Différences de la Version Japonaise |
|
NES Développeur: Chunsoft Editeur: Enix
Genre: RPG Joueurs: 1P Dates de sortie
27.05.1986 Japon
08.1989 USA
bonne Difficulté:
52%Graphismes 35%Animation 78%Son 75%Jouabilité 90%Durée de vie 68%68%
Death Necklace:
Le Collier de la Mort est caché dans le souterrain entouré par des montagnes à l'ouest. Il est dans le coffre au second sous-sol à gauche de l'escalier central. Le hic est que le contenu de ce coffre est produit aléatoirement et qu'il donne principalement des pièces d'or. Il faut donc y revenir plusieurs fois. C'est un objet maudit qu'il ne faut pas enfiler mais revendre pour un bénéfice de 1250 pièces d'or. |
Bonus ! x 2
Les Japonais adorent les jeux de rôle Dragon Quest. Mais plus on s'éloigne de l'épicentre — de Tokyo, du Japon, de l'Asie — moins cette ferveur est ressentie, jusqu'à ce que l'on atteigne finalement les rivages de l'Europe où la saga, ici sans culte, a longtemps été un objet inconnu, réservé à l'import, que l'on se passait de mains en mains sans comprendre. Indéchiffrable, Dragon Quest l'a été pendant vingt ans, jusqu'à ce que Enix, qui entre-temps s'était marié avec son pire ennemi, se décide à passer à la traduction et sorte une certaine Odyssée du Roi Maudit sur Playstation 2, portant aussi le nom de Dragon Quest VIII. Autant dire qu'en commençant la série à partir du huitième volet, en éclipsant vingt ans d'histoire de RPG japonais, le joueur français avait tout raté. Les Américains, eux, furent bien moins mal servis. Grâce à l'initiative de Nintendo, ils eurent droit sur NES, de 1989 à 1992, aux quatre premiers épisodes de Dragon Warrior, le nouveau nom de Dragon Quest imaginé spécialement pour le haut du continent. Mais quand vint le passage à la Super NES, plus rien ! Aucun des deux épisodes de la Super Famicom, ni le remake des deux premiers sur 8-bit ne leur fut offert et ils durent attendre que la Playstation s'emparât du marché pour reprendre contact avec ce RPG dont, heureusement pour eux, tous les scénarios sont indépendants les uns des autres. En France, à vrai dire, on n'était pas passé loin de faire connaissance avec DQ. Cela surprendra peut-être quelques lecteurs, rappellera des souvenirs à d'autres, mais dans le catalogue officiel de Nintendo/Bandai de 1989-90 sous forme de long dépliant, Dragon Warrior, photo à l'appui, était bel et bien annoncé. Mais alors, qu'est-ce qui rend Dragon Quest si passionnant, au moins pour les Japonais ? Il y a sans doute plusieurs réponses à cela, cependant il faut déjà avouer que Dragon Quest I sut être présent au bon moment. La Famicom débutait, sa collection riche en jeux d'action était pour ainsi dire dépourvue de jeux de rôle qui apprenaient timidement à franchir le pas sur consoles. En fait, avant Dragon Quest, il n'y avait eu qu'un seul RPG sur Famicom, Hydlide Special de T&E Soft (Toshiba et Emi), utilisant le système de coups par contact que popularisera Ys de Falcom et tombant, par conséquent, dans la catégorie des Action RPG. Avec son système de combat au tour par tour, Dragon Quest amenait quelque chose d'inédit sur Famicom. Et puis Enix avait été rusé comme le diable: pour s'occuper du design des personnages, et en particulier de celui des monstres, ils avaient fait appel à un jeune auteur de 29 ans qui connaissait un "certain" succès avec un manga qui, en cette année 1986, venait de débuter sur les télévisions japonaises. Le nom de cet homme était Akira Toriyama, et celui de sa série, Dragon Ball. Inconsciemment, on aurait tendance à minimiser l'impact qu'a eu Toriyama sur le contenu du jeu tant celui-ci est ancien, visuellement sec et étriqué, a priori si éloigné des créations délirantes du dessinateur. Ce serait peut-être la plus grave erreur de jugement dans l'explication du succès de la série. Si Enix a pris soin de ne jamais se séparer de Toriyama, si celui-ci officie toujours comme character designer dans Dragon Quest IX (annoncé pour l'année du même chiffre), ce n'est pas par simple nostalgie. Mais laissons cela pour le moment. D'un bond dans le temps, détournons-nous des polygones et des couleurs par milliers dont Dragon Quest s'est épris ces dernières années. Le héros, en 1986, porte trois couleurs, deux mouvements (pied gauche, pied droit) et un casque à cornes. Il n'a même pas d'épée au départ et sa première arme sera, comble de l'humiliation, un bâton de bambou. Son or et son expérience sont à zéro, le reste de ses caractéristiques (force, agilité, attaque, défense, vie, magie) à peine plus hautes. Il n'a qu'une seule chose prestigieuse: sa généalogie. Il est le descendant d'Erdrick, qui a repoussé les forces du mal grâce à un globe de lumière. Seulement, avec cet héritage lui imcombe une responsabilité, celle de sauver le pays de nouveau menacé par les forces du mal menées cette fois-ci par le Dragonlord. Le jeu s'ouvre sur une salle qu'on a du mal à identifier. On a beau faire face au roi Lorik, coincé entre cinq blocs, on se la représente difficilement comme la salle du trône. Avec Dragon Quest, il faut apprendre à faire un effort d'imagination car le graphisme dramatiquement désuet des niveaux, composé entièrement de tuiles de 16 pixels carrés, personnages compris, est aussi expressif que des briques Lego ("Duplo", corrigeront les plus cyniques). Ce ne serait pas un problème en soi si les dites tuiles n'étaient aussi peu variées: une pour le sol, une pour les murs, une intermédiaire; ajoutez-y les surfaces (sable, plaine, forêt, eau) et les points d'interaction (portes, escaliers, coffres), et vous tenez l'essentiel du graphisme, quel que soit l'endroit du jeu où vous vous trouvez, carte, village ou souterrain. Bien sûr, c'est en grande partie la faute à l'espace mémoire, lui-même dépendant de la technologie de l'époque. 1986, après tout, est aussi l'année de sortie de Super Mario Bros qui, s'il accomplit des miracles en terme de level design qui échappent complètement aux autres, n'était guère plus riche en graphismes. Dragon Quest I, contrairement à Final Fantasy I, c'est encore la génération de jeux de rôle primitifs et pas seulement du point de vue artistique. L'interface est aussi très textuelle, comme sur ordinateurs où le mouvement RPG a débuté. Lorsque l'on adresse la parole à un personnage, l'espace visuel s'atrophie, broyé sous les énormes cadres noirs des menus. La fenêtre principale comporte huit fonctions dont la moitié semble superflue: Stairs, Door, Search, Take. Pour accomplir des actions aussi simples que de franchir une porte ou descendre un escalier il faut passer par ce menu. Cela fait clairement partie des mauvais points, d'autant plus injustifiables que ce genre de contraintes n'a jamais vraiment été d'actualité sur consoles. Les combats eux sont très bavards et profitent de la large fenêtre réservée aux dialogues; à cause de sa taille et de son système de commandes, on se croirait presque en train de livrer bataille sur le MS-DOS prompt (l'interpréteur de commandes de Microsoft). Les assauts y sont décrits dans un verbiage trop abondant, futile, emporté de toute façon avant qu'on ait dénié y poser les yeux. A propos du texte en anglais, les traducteurs ont dû être impressionnés par la prose de Lord British (voir par exemple Ultima IV sur Master System), les personnages s'exprimant avec des pronoms périmés, des "thou", des "thy" et des "thee" shakespeariens, qui alourdissent la lecture et n'aident pas le jeu à se débarrasser de son côté antiquité poussiéreuse. La seule chose qui apporte un peu de contraste à l'ensemble sont les monstres conçus par Toriyama, pas seulement parce que son style moderne et frais est plus résistant au temps qui passe comme le prouve chaque nouvelle génération de fans, mais parce que c'est le seul élément graphique qui est présenté dans un format pour une fois plus large que la terrible tuile. La simplicité de l'interface des menus a quand même du bon. Pour un RPG, tout est direct et concis, au point que Chunsoft se paye le luxe de n'utiliser que les deux boutons d'action de la manette, A et B, respectivement pour valider et annuler. Aussi facile que ça ! Du coup, les transactions commerciales sont du gâteau: la toute nouvelle armure que vous venez d'acheter pour 3000 pièces d'or remplace l'ancienne, instantanément revendue et payée. Les puristes se plaindront peut-être que cela ruine tout le plaisir de s'équiper et gérer son bien, mais qu'y a-t-il de plus pur parmi les RPG japonais que Dragon Quest I ? Et puis de toute façon, il n'y pas le temps de jouer au marchand, il faut se battre, se battre et encore se battre. C'est que la formule du jeu est elle aussi on ne peut plus sommaire. Le monde d'Alefgard a une topographie circulaire qui entoure l'île sur laquelle se trouve Charlock, la forteresse du Dragonlord. Ce n'est pas une de ces cartes immenses sur lesquelles on ne cesse de se perdre: le pays n'est pas bien grand, il n'y a que cinq villes et à peu près autant de vrais donjons. Les voies sont claires, spacieuses et les régions bien définies, moins par leur géographie que par la force de leurs monstres. Ce sont eux, et pendant longtemps uniquement eux, qui composent la progression dans le jeu. Il n'y a rien d'autre à faire que de combattre, pour recevoir des points d'expérience et de l'or, et donc des niveaux et de nouvelles armes, dans le seul but d'accroître sa force pour avancer un peu plus loin dans la zone qui nous était jusqu'ici interdite. C'est le leveling-up des RPG, la corvée d'augmentation de niveaux, dans toute son horrible splendeur. Le reste, c'est à dire les villages, leurs habitants, et même les objets, n'a qu'un rôle superflu, presque accessoire. On achète surtout des torches pour s'aventurer dans des donjons ténébreux, véritables hantises de claustrophobes, qui ne recèlent souvent rien qu'on ne puisse remettre à plus tard. Délivrer la princesse, qui semble être notre premier objectif et le seul véritable intérêt des souterrains septentrionaux, n'a lieu qu'après avoir atteint un niveau d'expérience élevé, vers la moitié du jeu, afin de tuer un boss squameux qui par la suite rejoindra le commun des ennemis. Après, les quêtes d'artéfacts sacrés peuvent s'enchaîner: Silver Harp, Staff of Rain, Stones of Sunlight, comme un jeu de piste conduisant à l'épée d'Erdrick que l'on conduira à son tour dans le coeur du Dragonlord. Cette seconde partie pourtant n'est guère plus mouvementée que la première, elle se déroule sur le quart de cercle sud-ouest d'Alefgard et sur l'île qui abrite l'effroyable forteresse construite en labyrinthe à escaliers. Avant de pouvoir y poser pied, le "leveling-up", que l'on croyait déjà pratiquer à un rythme soutenu, va s'intensifier. Le niveau maximum de 30, obtenu avec 65535 points d'expérience, n'est pas vite atteint contrairement à ce que l'on pourrait croire; cela parce que les monstres sont avares de points: jamais plus d'une dizaine à la fois parmi les plus forts et à l'unité parmi les autres. Vers le niveau 21, quand on doit être en mesure de rejoindre Charlock, on ne dispose que de la moitié du nombre total de points d'expérience ! Pour s'assurer d'une victoire contre le Dragonlord, bien des combats seront encore à livrer. Dragon Quest, c'est l'incarnation archaïque du jeu de rôle console, celui où le scénario et les évènements ne servent que de toile de fond et ne sont pas des pivots du gameplay. Ce n'est pas nécessairement synonyme d'échec, c'est un versant épuré du genre, fort populaire aussi. Prenez Pokémon, la formule en est très proche: peu de scénario, l'accent est mis sur les monstres, les combats et la quête de puissance. C'est malgré tout prenant et aujourd'hui l'un des plus grands succès de la planète, loin devant des RPG aux concepts plus sophistiqués. Preuve s'il en fallait une que les jeux vidéo sont primordialement des jeux et pas des oeuvres mues par des scénarios, rôle qui sied tellement mieux aux cinémas et aux littératures de tout bord. Malgré les combats qui ont tendance à dévaloriser les autres aspects du jeu, il y a du charisme qui émane de Dragon Quest mais comme une fragrance que le temps ne serait pas parvenu à complètement effacer. Ce qu'il reste surtout de lui après toutes ces années c'est son minimalisme: l'interface primitive, la simplicité du graphisme qui donne par moments l'impression d'évoluer parmi des pictogrammes, la musique a deux bips, pourtant bonne, un monde et une quête dépourvus d'envergure, et puis toutes ces astuces pour gagner de l'espace mémoire que l'on ne peut s'empêcher d'admirer. Le mérite moderne de Dragon Quest I, c'est d'être un RPG de poche, une formidable miniaturisation du genre qui s'y prête le moins bien, lui dont la densité et la longueur ont fait sa réputation au cours des années. Et c'est aussi, comme on le sait, le début d'une grande saga. Grande en particulier par ses chiffres de vente. Quand on regarde ce premier Dragon Quest sur Famicom, vendu à un million et demi d'exemplaires, on a du mal à décider si son futur était prévisible et mérité, contrairement par exemple à The Legend of Zelda qui affirme son génie de la première à la dernière minute. Il y a du pour et du contre, quelques idées marquantes (tout ce qui implique la princesse bizarrement est très original) et des défauts conséquents. C'est à ce moment qu'on pense à Akira Toriyama. La popularité de ses créations, en 1986, était gigantesque. Il avait terminé Dr. Slump et commencé Dragon Ball, tous les deux des best-sellers de Shonen Jump écoulés respectivement dans leur carrière japonaise à 35 et 150 millions d'exemplaires. En marquant de son style, si reconnaissable, les illustrations de Dragon Quest, c'est peut-être lui, plus encore que son créateur, Yuji Horii, qui aura déterminé le succès de la série. le 20 février 2009 par sanjuro Jeu testé en version américaine
|
Boîte du jeu Version japonaise  Photos choisies Cliquer pour agrandir Toutes les photos Taille normale 256x224
01 |
02 |
03 |
04 |
05
Panorama06 | 07 | 08 | 09 | 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 | 25 26 | 27 | 28 | 29 | 30 31 | 32 | 33 | 34 | 35 36 | 37 | 38 | 39 | 40 Tout sur une page 
|